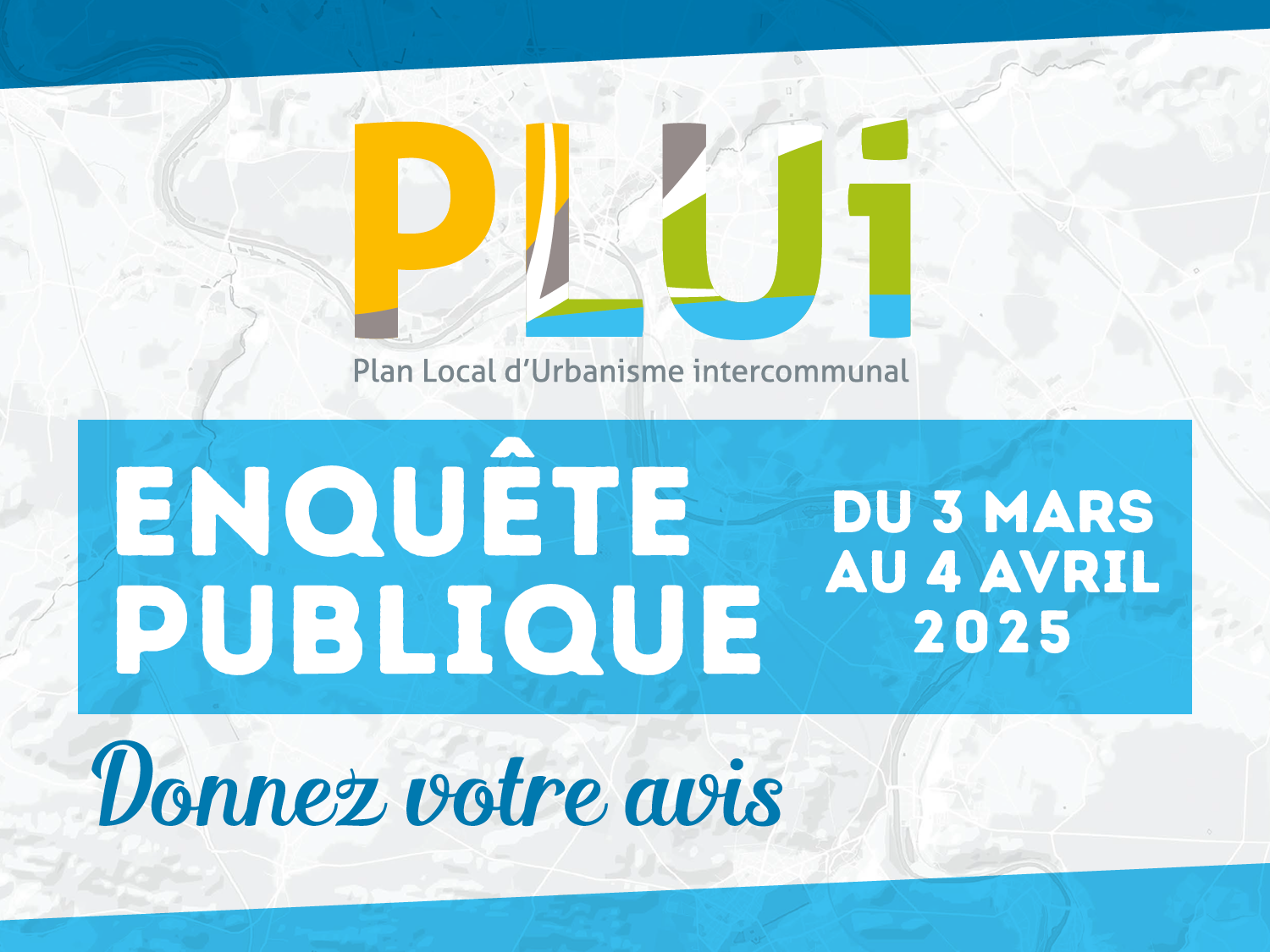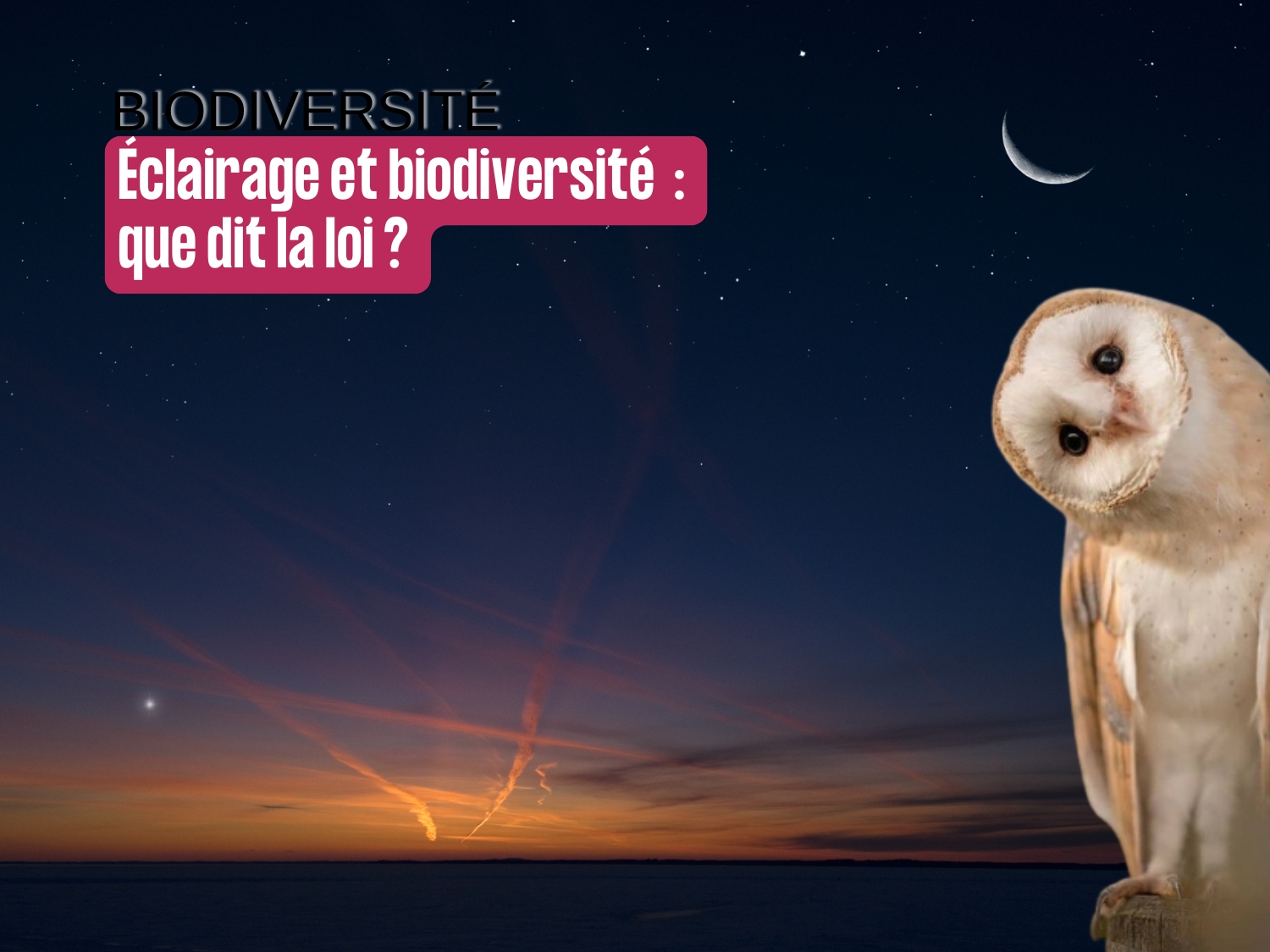L’impact de l’éclairage artificiel sur la biodiversité est un sujet pris en compte par la législation depuis le Grenelle de l’Environnement de 2010. Depuis, plusieurs textes de loi ont été adoptés pour encadrer et limiter les nuisances lumineuses.
L’article L.583-1du code de l’environnement précise les 3 raisons de prévenir, supprimer ou limiter les émissions de lumière artificielle lorsque ces dernières :
- Elles sont de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes,
- Elles entraînent un gaspillage énergétique
- Elles empêchent l’observation du ciel nocturne.
L’article L583-3 précise l’autorité compétente pour s’assurer du respect de ces dispositions qui selon les cas est le maire ou le préfet.
De nouvelles lois sont venues renforcer la protection :La loi sur la transition énergétique de 2015 a abordé le sujet sous l’angle de la maitrise des consommations.
La loi sur la biodiversité de 2016 va plus loin en reconnaissant les paysages nocturnes comme une partie intégrante de notre patrimoine commun. Elle insiste sur la nécessité de préserver les continuités écologiques et la qualité paysagère, notamment dans les espaces naturels et marins.
Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l’utilisation durable des continuités écologiques.
Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement, y compris nocturne. Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
Enfin l’arrêté du 27 décembre 2018, modifié en 2019, apporte des règles précises pour encadrer l’éclairage artificiel et limiter son impact. Il fixe des prescriptions temporelles et techniques à respecter en fonction des zones concernée

Pour la temporalité, l’arrêté du 27 décembre 2018 reprend les plages horaires existantes mais précise un certain nombre de cas particuliers. Par exemple les lumières éclairant le patrimoine et les parcs et jardins accessibles au public devront être éteintes au plus tard à 1 h du matin ou 1 h après la fermeture du site ; les éclairages des vitrines de magasins, de commerce ou d’exposition devront être éteints au plus tard à 1 heure après la fin d’occupation…
Ces règles (sauf les éclairages pour les chantiers) peuvent être adaptées si l’éclairage est couplé à des détecteurs de présence ou à un dispositif asservi à la lumière naturelle.
Le texte prévoit aussi que les préfets peuvent prendre des dispositions plus restrictives pour tenir compte de sensibilité particulière aux effets de la lumière d’espèces faunistiques et floristiques ainsi que pour les continuités écologiques
Le maire peut déroger aux dispositions pour l’éclairage de mise en valeur de patrimoine et des bâtiments non résidentiel lors des veilles des jours fériés chômés et durant les illuminations de Noël. Les préfets peuvent déroger à ces mêmes dispositions, lors d’événements exceptionnels à caractère local définis par arrêté préfectoral et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente.
L’arrêté fixe aussi des prescriptions techniques (la répartition du flux lumineux sur une surface donnée, la température de couleur …) à respecter en agglomération et hors agglomération, ainsi que dans des espaces naturels protégés. L’objectif est de réduire l’intensité lumineuse des luminaires en alliant sécurité et visibilité des personnes et limitation des impacts sur la biodiversité.
Les émissions de lumière artificielle des installations d’éclairage extérieur et des éclairages intérieurs émis vers l’extérieur sont conçues de manière à prévenir, limiter et réduire les nuisances lumineuses, notamment les troubles excessifs aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne.

Les installations d’éclairage ne doivent pas avoir une proportion de lumière émise au-dessus de l’horizontale de plus de 1%.
Dans les zones qualifiées de réserve naturelle, les corridors écologiques et leur périmètre de protection cette part est ramené à 0% et la température de couleur ne doit pas y dépasser 2400 Kelvins (K : unité de base de température thermodynamique dans le Système international).
Il est interdit d’éclairer directement les cours d’eau, le domaine public fluvial (DPF), les plans d’eau, lacs, étangs et le domaine public maritime.
Les luminaires installés après le 1er janvier 2020 doivent être conformes à l’ensemble des dispositions. Pour les luminaires existants, l’entrée en vigueur varie selon la disposition et le type de luminaire.
Si les luminaires ont une proportion de lumière supérieure à 50% au-dessus de l’horizontale (lampes boules par exemple), ceux-ci doivent être changés depuis le 1er janvier 2025.
Les mesures liées à la temporalité sont effectives depuis le 1er janvier 2021, lorsqu’elles ne requièrent pas la création d’un réseau d’alimentation séparé. Les mesures de temporalité concernant l’éclairage de bâtiments non résidentiels et l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur sont en vigueur, puisqu’elles étaient déjà présentes dans l’arrêté du 25 janvier 2013.
Enfin, l’arrêté introduit un volet de contrôle : chaque gestionnaire d’un parc de luminaires devra avoir en sa possession un certain nombre d’éléments permettant de vérifier la conformité des installations d’éclairage :
- la proportion (en %) de lumière émise par le luminaire au-dessus de l’horizontale ;
- la proportion (en %) de lumière émise par le luminaire dans un cône de demi-angle 75,5°, par rapport à la lumière émise sous l’horizontale ;
- la température de couleur (en kelvins) nominale de la lumière émise par la source ;
- la puissance électrique (en watts) du luminaire en fonctionnement au régime maximal ;
- le flux lumineux (en lumen) nominal de la source en fonctionnement au régime maximal ;
- la date d’installation de la tête du luminaire.

L’extinction de l’éclairage public et la “trame noire”
L’extinction nocturne de l’éclairage public relève de la responsabilité du maire et de son conseil municipal. Le sujet est complexe car il faut tenir compte de la spécificité des divers endroits de la commune :
- des activités (restaurants, spectacles, manifestations diverses…) qui en période hivernale peuvent se poursuivre longtemps en dehors des phases d’éclairage naturel
- des endroits pouvant présenter un risque particulier
- des espaces naturels protégés, des plans d’eau et des continuités écologiques
- etc.
Quoi qu’il en soit, de plus en plus de communes recourent à une extinction nocturne de durée variable. Cela permet de réduire la consommation d’énergie et de restaurer des cycles naturels pour la faune et la flore locales. Contrairement aux idées reçues, l’extinction nocturne n’entraîne pas une augmentation de la délinquance. Au contraire :
- Les études montrent que l’absence d’éclairage ne favorise pas les cambriolages ou les agressions.
- Les malfaiteurs ont besoin de lumière pour commettre leurs actes. Dans le noir, une lampe de poche attire l’attention.
- Des solutions existent pour adapter l’éclairage aux besoins spécifiques (détecteurs de mouvement, horaires ajustés…).
L’enjeu de la trame noire : un corridor écologique nocturne
À l’image des trames vertes et bleues, qui identifient des zones riches en biodiversité et les corridors écologiques qui permettent à la faune de passer de l’une à l’autre, la trame noire vise à préserver les zones d’obscurité indispensables à la vie de la biodiversité. Comme l’éclairage diffuse, la trame noire concerne aussi l’environnement proche des lieux ainsi identifiés.
L’agglomération du Pays de Fontainebleau avec le PNR du Gâtinais, la forêt de Fontainebleau, les vallées de la Seine et des rivières… comprend énormément de zones riches en biodiversité où l’éclairage nocturne est banni. Nous attendons évidemment que les collectivités respectent les règlementations. Mais qu’en est-il des particuliers ?
Il est du devoir de chacun… dit la loi mais il n’est pas possible de contrôler tous les habitants, seule la sensibilisation peut porter des fruits.
Vers une prise de conscience collective
La trame noire ne peut être efficace que si elle est respectée par tous, y compris les entreprises et particuliers.
- Limiter au maximum l’éclairage du jardin, des façades, des parkings
- S’il faut maintenir un peu d’éclairage le choisir plus respectueux (LEDs ambrées, lumière dirigée vers le sol) afin de concilier sécurité et biodiversité.
🌙 Ces trois articles (voir ICI et ICI) ont tenté de vous expliquer pourquoi l’éclairage nocturne est nocif pour la biodiversité. Comme vous avez pu le lire, la législation évolue doucement car le sujet est complexe et les changements d’équipements ont un coût. Mais, si chacun d’entre nous comprend la nécessité de faire un geste pour la tranquillité nocturne de la faune et de la flore, alors chaque effort participera à la création de véritables trames noires qui seront profitables à tous.